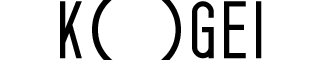Qu’est-ce que l’Imari-yaki et l’Arita-yaki ?
L’Imari-yaki et l’Arita-yaki désignent deux grandes traditions de porcelaine japonaise, toutes deux originaires de la région d’Arita, dans la préfecture de Saga, sur l’île de Kyūshū.
Ces porcelaines se distinguent par leur légèreté, leur finesse et leur grande robustesse, obtenues grâce à l’utilisation d’une pierre à porcelaine locale d’exception. Leur esthétique repose sur une palette emblématique : un blanc éclatant, relevé de motifs indigo et rouge vif, parfois enrichis de touches d’or.
Historiquement, la distinction entre Imari et Arita provient des lieux d’expédition : les pièces étaient produites autour d’Arita, mais exportées depuis le port d’Imari, d’où la double appellation. Aujourd’hui, on parle d’Arita-yaki pour les pièces cuites à Arita, et d’Imari-yaki pour celles cuites à Imari, même si leur histoire et leur style restent intimement liés.
Histoire : des origines à l’âge d’or de la porcelaine japonaise
L’histoire de l’Imari-yaki et de l’Arita-yaki débute en 1616, à l’époque d’Edo, avec la découverte du gisement de pierre à porcelaine par le potier coréen Sam-Pyeong Yi, accompagné du seigneur Nabeshima Naoshige. Les premières productions, vers 1650, sont plutôt simples et épaisses, ornées uniquement de bleu (gosu) appliqué sous émail.

Un tournant majeur survient en 1647, lorsque la famille Kakiemon Sakaida introduit la technique du décor sur couverte (overglaze). C’est à cette période que naît le style aka-e, où le rouge vif domine, bientôt imité par les grandes manufactures européennes comme Meissen.
Vers 1688, le style kinrande apparaît : des motifs somptueux en rouge et or couvrent alors toute la surface des pièces, incarnant le raffinement de la porcelaine japonaise.
À la fin du XIXe siècle, l’introduction du cobalt comme matière première pour l’indigo (gosu) permet une diffusion rapide de ce style dans tout le pays.

Les grandes étapes de fabrication de la porcelaine d’Imari et d’Arita
1. Préparation de la terre
La pierre à porcelaine, extraite des carrières d’Izumiyama ou d’Amakusa, est soigneusement sélectionnée. Elle est d’abord concassée, puis broyée mécaniquement en une poudre très fine. Cette poudre est ensuite placée dans un bassin d’eau pour une opération d’élutriation, qui permet d’éliminer les impuretés comme le fer. Une fois l’excès d’eau retiré, on obtient une argile de grande pureté, prête à être façonnée.
2. Façonnage
Avant tout modelage, l’argile est longuement pétrie afin d’en chasser l’air et d’assurer une homogénéité parfaite de l’humidité et de la granulométrie. Ce pétrissage, appelé aussi « battage », est essentiel pour prévenir l’apparition de fissures lors de la cuisson. L’argile ainsi préparée est ensuite façonnée sur un tour de potier, à la main ou à l’aide de moules, selon la forme désirée.
3. Finitions et séchage
Une fois la forme obtenue, les détails tels que le pied, les anses ou les bords sont ajoutés avec soin. À cette étape, certains motifs peuvent être sculptés, selon les styles. Le séchage doit s’effectuer lentement afin d’éviter toute déformation ou fissure du tesson.
4. Première cuisson (biscuit)
Lorsque la pièce est parfaitement sèche, elle subit une première cuisson, dite « biscuit », à une température comprise entre 850 et 950°C. La montée en température se fait progressivement pour préserver l’intégrité de la pièce, tout comme le refroidissement, qui doit être lent.

5. Décor sous émail
Après la cuisson du biscuit, la décoration sous émail est appliquée. Le pigment principal utilisé est le gosu, à base d’oxyde de cobalt, qui confère à la porcelaine ses nuances indigo caractéristiques. Les variations de teinte sont obtenues par dilution à l’eau. Les dessins, parfois très fins, sont tracés à ce stade, avant l’application de la glaçure.
6. Glaçure
Une couche fine et régulière de glaçure est appliquée sur la pièce décorée. Cette opération vise à vitrifier la surface lors de la cuisson, rendant la porcelaine plus résistante, lisse, brillante et moins sujette aux taches. L’excédent de glaçure est retiré du pied de la pièce, puis celle-ci est à nouveau séchée.
7. Cuisson finale
La pièce émaillée est cuite à haute température, autour de 1 300°C, pendant environ 16 heures. Si aucune décoration supplémentaire n’est prévue, la pièce est alors achevée à l’issue de cette étape.
8. Décor sur émail (peinture sur glaçure)
Pour les pièces nécessitant des décors complémentaires, notamment les rouges emblématiques de l’Imari et de l’Arita, la peinture sur émail intervient après la cuisson finale. Les pigments utilisés supportant moins la chaleur, une cuisson supplémentaire à basse température (700 à 800°C) est réalisée pour fixer ces décors. Si des ornements en or ou en argent sont ajoutés, une ultime cuisson à environ 400°C est nécessaire, après application des feuilles métalliques et d’une glaçure spécifique, selon la technique dite nishikigama ou kingama.
Ce processus rigoureux, fruit d’un savoir-faire ancestral, confère à la porcelaine d’Imari et d’Arita sa finesse, sa robustesse et l’éclat de ses couleurs.
Ateliers emblématiques et artistes
Parmi les ateliers historiques, citons le Gen’emon-gama (fondé en 1753) et le Kakiemon-gama (fondé en 1616), qui perpétuent la tradition et l’innovation de l’Imari-yaki et de l’Arita-yaki. De nombreux artistes contemporains, dont certains Trésors Nationaux Vivants, continuent de faire rayonner cet art au Japon et dans le monde.
Héritage et influence
L’Imari-yaki et l’Arita-yaki incarnent la délicatesse et la grâce de l’art japonais, alliant tradition, innovation et beauté intemporelle. Leur influence s’étend bien au-delà du Japon, ayant inspiré les plus grandes manufactures européennes et séduit collectionneurs et amateurs d’art du monde entier.
Plus d’informations sur la céramique Imari ? Visionnez le live de KogeiSan disponible en replay sur Youtube :